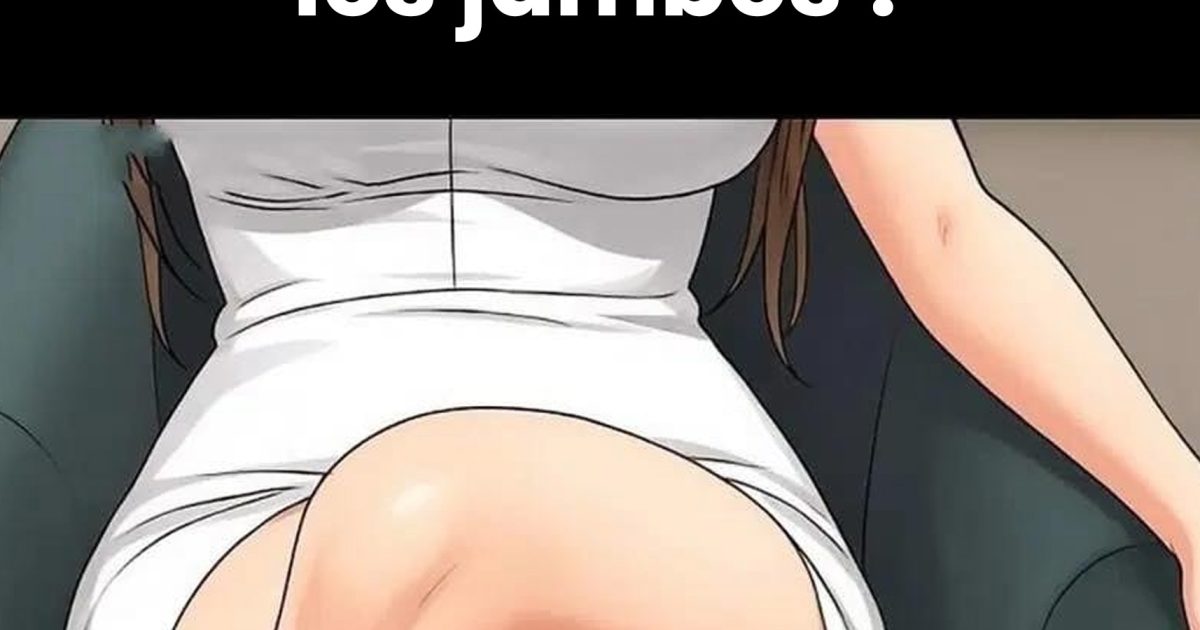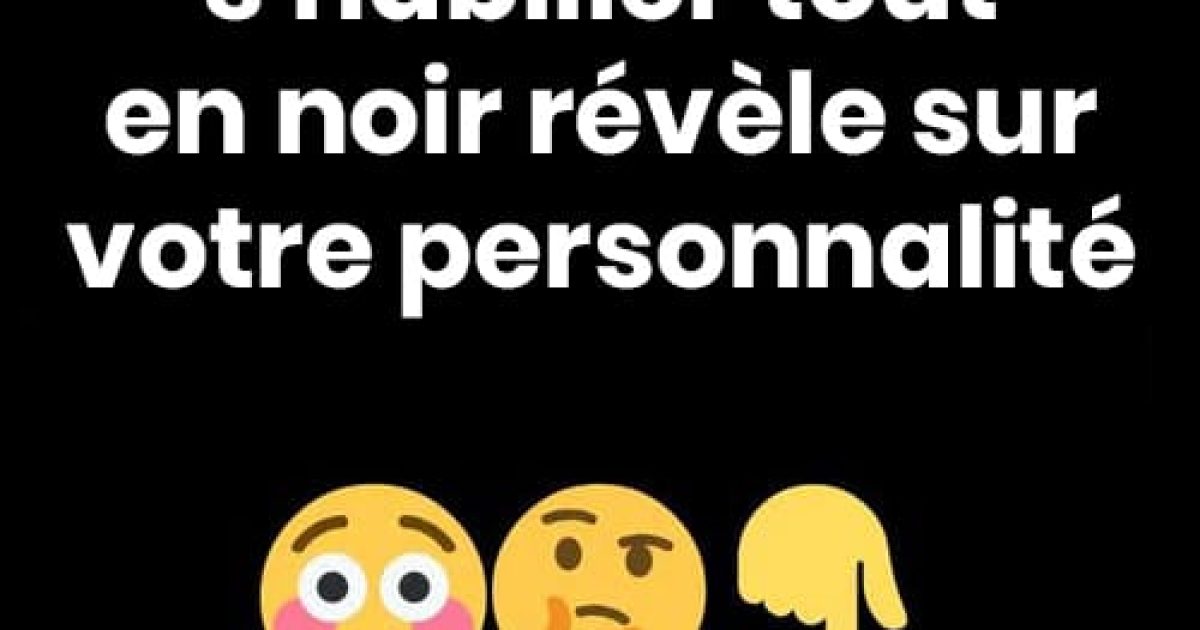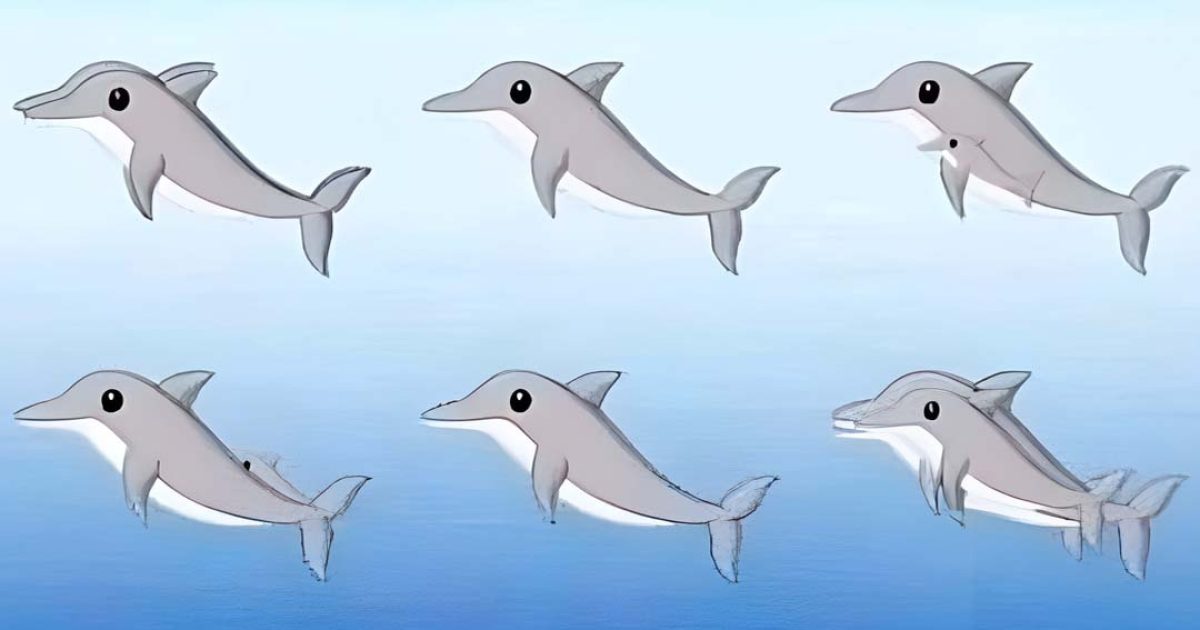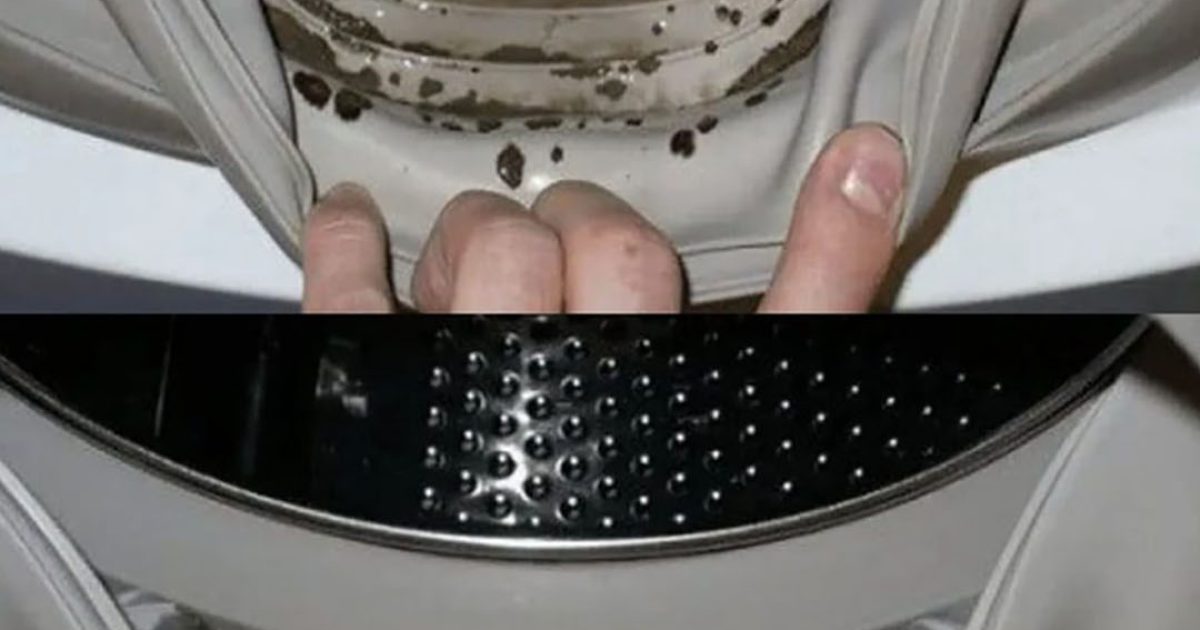Le langage corporel féminin : ce que votre position assise révèle de vous
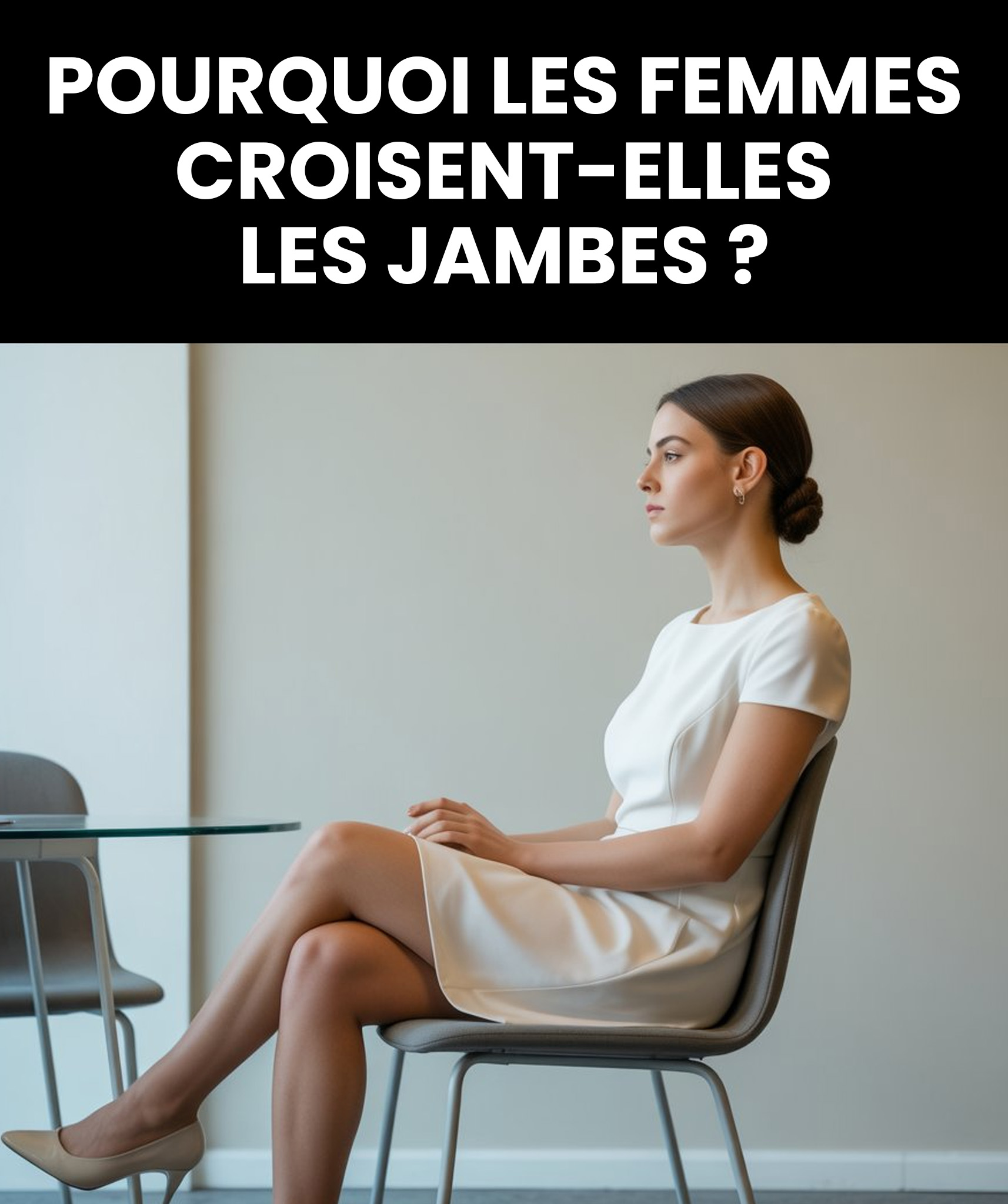
Ce geste apparemment anodin qu'est la manière de s'asseoir dévoile des influences culturelles et sociales profondes. Découvrez comment votre posture quotidienne communique bien plus que vous ne l'imaginez sur votre héritage sociétal.
Notre façon de nous asseoir : un héritage culturel qui nous façonne

Ce geste est tellement intégré à notre quotidien qu’on en oublie presque qu’il existe. Pourtant, la manière dont nous entrelaçons nos jambes n’a rien d’inné – elle s’inscrit dans un apprentissage social complexe. Au siècle des Lumières en Europe, cette attitude incarnait la distinction et les convenances, permettant d’afficher son raffinement et sa retenue. Les manuels de bienséance de l’époque ne laissaient aucune place au doute : une femme de bonne société se devait d’adopter une posture réservée et maîtrisée.
L’influence culturelle demeure pourtant déterminante. Dans certaines régions d’Asie, notamment au Japon et en Corée, adopter cette position devant des aînés ou dans des circonstances officielles peut être considéré comme une marque d’irrespect. La coutume locale valorise plutôt une assise droite et équilibrée, les deux pieds ancrés au sol. Cela illustre parfaitement comment un simple mouvement peut porter des interprétations diamétralement opposées selon les latitudes !
Aujourd’hui encore, ces traditions séculaires continuent d’imprégner nos comportements modernes. Entre les canons véhiculés par les médias, les conventions tacites et les influences sociales parfois imperceptibles, croiser les jambes reste un automatisme pour beaucoup d’entre nous… même quand cela se fait au détriment de notre confort personnel.
Le langage silencieux de notre posture assise

Au-delà des considérations culturelles, la façon dont nous disposons nos jambes peut trahir nos émotions les plus intimes. Il s’agit d’un authentique moyen d’expression non verbale. Nous négligeons souvent que notre corps parle pour nous, généralement avant même que nous n’ayons ouvert la bouche.
Une jambe repliée sur l’autre, dirigée vers notre vis-à-vis ? Cela peut suggérer de l’intérêt, voire une certaine complicité. Des jambes étroitement croisées et repliées vers le buste ? Indice d’une recherche de sécurité, d’un désir d’établir une barrière rassurante. À l’inverse, une posture déliée, les deux pieds fermement posés sur le sol, diffuse généralement une impression de tranquillité et d’assurance.
Et saviez-vous que ces comportements ne sont pas distribués de manière égale ? Dès l’enfance, les petites filles reçoivent des incitations – fréquemment implicites – à « adopter une tenue correcte », à « disposer élégamment leurs jambes », tandis que les garçons jouissent d’une latitude posturale bien plus large, pouvant s’installer avec désinvolture. Une différence qui semble anodine, mais qui en dit long sur les attentes genrées inculquées dès le plus jeune âge.
L’importance de la posture assise dans le monde professionnel

Dans le cadre professionnel – que ce soit au travail, durant une réunion ou lors d’un entretien d’embauche – notre manière de nous asseoir peut influencer la perception que les autres ont de nous. Les études en psychologie sociale l’ont maintes fois démontré. Une attitude corporelle raidie risque d’être perçue comme un manque de confiance. À l’opposé, une position décontractée, stable et harmonieuse envoie un message clair : « Je suis à ma place ici. »
Pour les femmes, cet aspect constitue souvent un véritable dilemme. Comment allier aisance personnelle et projection d’une image compétente et professionnelle, sans être étiquetée comme « trop virile » ou « pas assez déterminée » ? Effectivement, même dans la simple manière de s’asseoir, nous devons constamment jongler entre authenticité et conformité aux normes établies.
Et si nous arrêtions de juger… la façon de s’asseoir ?
Finalement, ce geste apparemment anodin ouvre la voie à une réflexion plus profonde : celle de la liberté corporelle. Pourquoi certaines postures demeurent-elles considérées comme plus « appropriées » pour les femmes ? Pourquoi la grâce serait-elle privilégiée au détriment du bien-être ? Et si nous commencions à remettre en question ces critères invisibles ?
Car au fond, prendre place, c’est aussi revendiquer sa place dans l’espace. Il est grand temps que chacun puisse le faire en toute sérénité, sans avoir à se justifier, sans contrainte, et sans redouter le regard des autres.